|
|
Un dispositif de projection peut être caractérisé par les aspects suivants :
- canaux : le nombre
de canaux de projection indépendants (correspondant au nombre de canaux du support en projection
directe), qui, en multiphonbie, est en principe égal au nombre d'enceintes.
Celles-ci peuvent néanmoins être plus nombreuses si certains canaux
sont
associés à des groupes d'enceintes (clusters) généralement pour
des questions de directivité
ou de puissance. Ceci ne change pas la nature du dispositif.
- dimensions : 0, 1, 2 ou 3 (voir
les dispositifs primaires) ;
-
plans : le nombre de niveaux de distance par rapport à l'auditeur ou à
un
point de référence, dans une direction donnée. Ils sont comparables à des pelures d'oignons
plus ou moins complètes. L'existence de plans permet de jouer
sur la distance projetée.
- directions : les
directions de projection des enceintes. Elles peuvent être parallèles
(toutes les enceintes sont orientées dans la même direction), convergentes
(toutes les enceintes sont focalisées vers un point unique), divergentes
(le contraire), ou quelconques. Le
paramètre de direction n'a de sens que si les enceintes sont directives.
Dans le cas d'enceintes omnidirectionnelles ou bi-directionnelles
(cas les plus fréquents) il convient bien sûr de le préciser. Les orientations d'enceintes
ayant un rôle avant tout d'effet acoustique (réflexions
sur les murs...) relèvent de "cas particuliers" non
pris en compte dans cette description...
- symétrie :
l'existence ou non d'un ou plusieurs axes de symétrie (radiale, axiale, sans
sysmétrie)
;
- environnement : la place de
l'auditeur par rapport à l'ensemble du dispositif. Il peut
se situer à l'intérieur de l'espace
délimité par les enceintes ("surround", disposition d'acousmonium
classique...), à l'extérieur
("sculptures sonores", il peut en faire le tour par exemple),
partiellement ou totalement.
- orientation : comment
le public est orienté par rapport à
l'ensemble du dispositif de projection s'il occupe une place
fixe. Dans le cas d'installations où le public se déplace, le dispositif
sera dit non orienté. Dans les autres
cas, si l'auditeur est assis ou contraint d'adopter une position
particulière, l'orientation peut être unique
(tout le monde est bien aligné...), radiale
ou multiple.
- taille
: la surface ou le volume en mètres occupés par le dispositif, sous
la forme de valeurs fixes ou de limites inférieures / supérieures,
ou par catégorie (petit, moyen, grand, très grand ?).
Note à propos de la symétrie
:
En projection directe multiphonique,
ou à plus forte raison en projection
simulée, il est important de ne pas
confondre l'implantation des haut-parleurs et la nature des masses
spatiales projetées. Même
si le dispositif détermine en grande partie les masses spatiales
possibles, il ne se confond pas avec elles, il les supporte.
Par
rapport à la projection interprétée de
supports "pocophoniques",
la notion de conservation de la "symétrie stéréophonique" ou,
si on le souhaite, de sa dissymétrisation n'a
plus lieu d'être,
car chaque objet peut posséder une masse spatiale qui
lui est propre, librement combinée et superposée aux autres,
et s'inscrivant dans le maillage du dispositif ainsi que le compositeur
l'a
souhaité, chacune étant aussi "dyssimétrique" qu'il le souhaite.
Lorsque le lieu ou un propos compositionnel ne l'impose pas,
une disposition non symétrique veut simplement dire que
l'on s'interdit certaines possibilités spatiales...
Ceci veut dire
que le choix d'implantations non symétriques que l'on peut
trouver dans l'implantation de certains acousmoniums pour des
raisons de stratégie
d'interprétation ou surtout d'esthétique visuelle ne possède
que très peu
d'intérêt en projection multiphonique, hormis bien sûr dans le
cas des installations ou de lieux à l'architecture particulière
(autre que parallélépipédique...) lorsque celui ci est pris
en compte dès la composition.
|
|
|
Note : si un certain nombre de dispositions
correspond précisément à une de ces catégories, de très nombreux
cas, comme les dispositions d'acousmoniums en concerts ou des installations,
se situent évidemment dans des situations intermédiaires et combinent
des caractéristiques de plusieurs d'entre elles.
|
|
Dispositifs
équidistants
focalisés
|
|
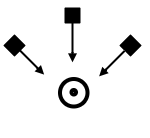 - canaux : 2 et plus - canaux : 2 et plus
- dimensions : 1
et plus
-
plans : 1
- directions : convergentes
- symétrie : (radiale)
- environnement : normalement
intérieur partiel ou total
- orientation : unique
ou radiale
- taille : ?
Dans ces dispositifs la
distance entre chaque projecteur et l'auditeur idéal est constante.
Il en résulte qu'une zone unique correspond au point où l'équilibre spatial
est optimum. Selon la résolution du dispositif, le nombre
de ses dimensions, sa taille, les techniques utilisées pour la création/contrôle
des espaces des sons projetés (HRTF, Ambisonic...) et la nature
de l'écriture spatiale (plus enveloppante ou plus cinétique),
la zone d'écoute acceptable peut être plus ou moins large, mais
de toute manière la perception spatiale devient de plus en déséquilibrée
à mesure qu'on s'en éloigne.
La plupart des dispositions d'écoute
sont à orientation unique, ce qui correspond à l'écoute assise traditionnelle
en concert ou à la maison.
Applications : quadri, formats "surround",
cercle octo classique, cube 8, sphère à la Stockhausen... La stéréo traditionnelle
représente un cas particulier où l'environnement est "extérieur
partiel".
|
|
Dispositifs
équidistants
directifs
|
|
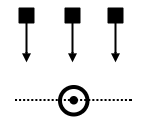 - canaux : 2 et plus - canaux : 2 et plus
- dimensions : 1
et plus
-
plans : 1
- directions : parallèles
- symétrie : ?
- environnement : extérieur
partiel
- orientation : unique
- taille : ?
Tous les projecteurs sont situés
sur un même plan et dirigés dans la même direction. La zone
d'écoute idéale est représentée par une ligne ou plutôt une bande
plus ou moins longue et large à l'intérieur de laquelle les points
d'écoute peuvent être différents mais restent convenables.
Applications : "mur" de haut-parleurs,
ligne octo des ateliers DeltaP...
|
|
Dispositifs
non
équidistants
|
|
 - canaux : 3 et plus - canaux : 3 et plus
- dimensions : 2
ou 3
-
plans : 2 et plus
- directions : parallèles (éventuellement par
groupes) ou convergentes
- symétrie : ?
- environnement : extérieur
partiel ou intérieur
- orientation : ?
- taille : ?
Cette disposition permet une profondeur
de champ permise par les différents plans de distance de
projection. Elle nécessite un dispositif à au moins deux dimensions
pour fonctionner correctement. Ces dispositifs peuvent être ou non
focalisés.
La taille de la zone d'écoute
convenable et sa position dépendent essentiellement de la valeur
de l'environnement, pouvant aller d'un point unique lorsque la direction
de projection est radiale (convergente) à une bande plus ou moins
large lorsqu'elle est multiple ou unique.
Applications : acousmoniums "scéniques"...
|
|
|
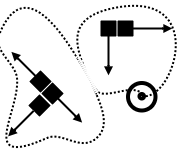 - canaux : 3 et plus - canaux : 3 et plus
- dimensions : 2
ou 3
-
plans : 2 et plus
- directions : quelconques, divergentes
- symétrie : ?
- environnement : extérieur
partiel ou total
- orientation : multiple
- taille : ?
Les enceintes sont rassemblées pour former un
ou plusieurs groupes où les projections sont généralement dirigées
vers l'extérieur du groupe. La zone d'écoute n'est pas circonscite
à une zone spécifique et l'auditeur peut prendre des positions et
des orientations variables.
Applications : installations...
|